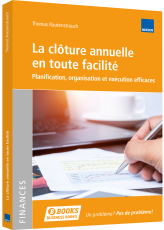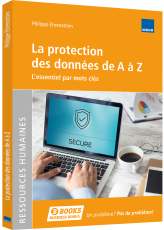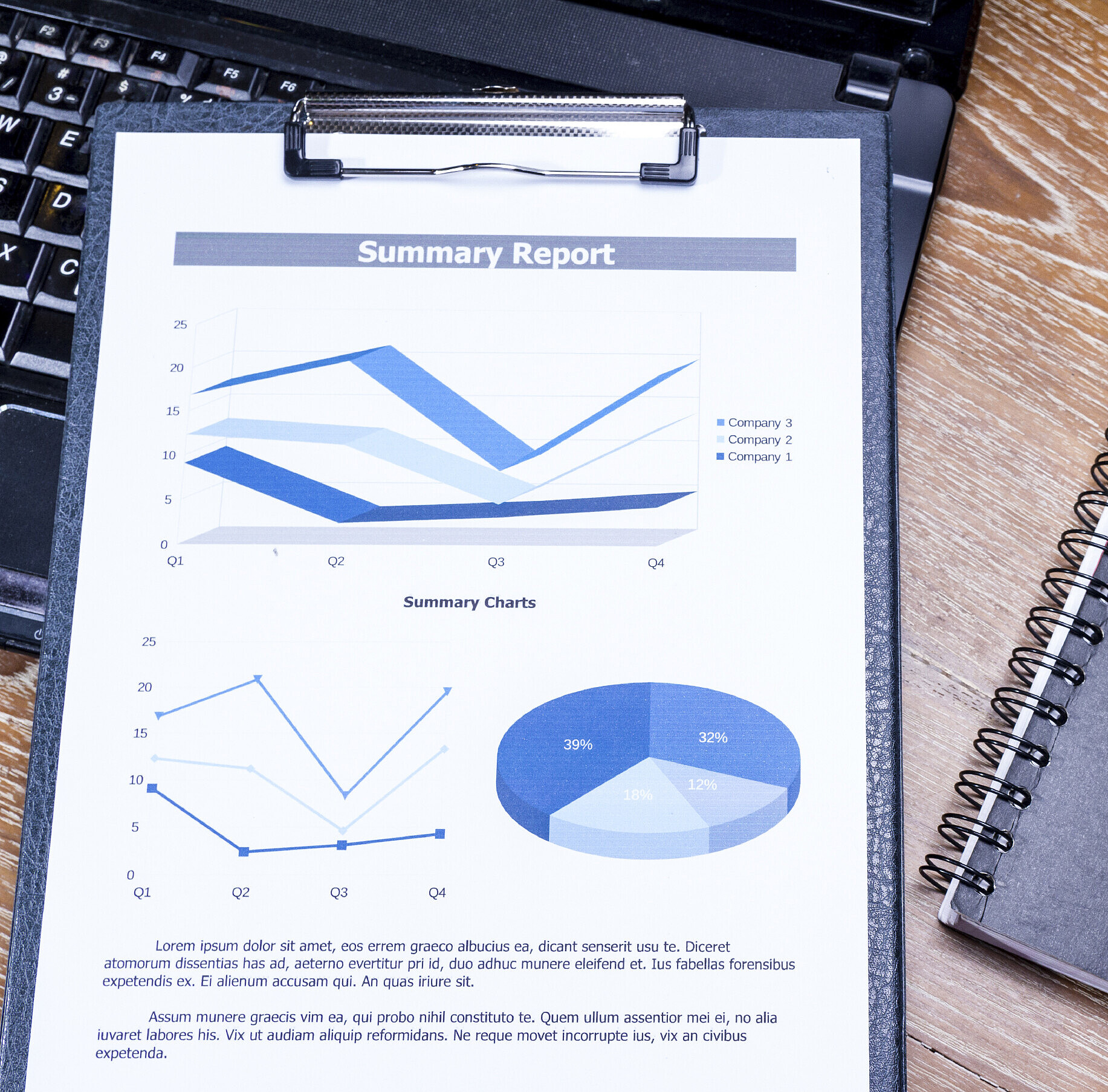Archivage numérique: Opportunités et défis

Aides de travail appropriées
Le mode de conservation au fil du temps
Le CO contient depuis 1976 les premières dispositions stipulant que les documents comptables peuvent être conservés non seulement sur papier, mais aussi sur des supports d’images et de données. A l’époque, les supports utilisés pour stocker les données étaient les bandes magnétiques et les microfilms.
L’évolution technique a nécessité une nouvelle modification de la loi le 1er juin 2002 afin de permettre l’utilisation des nouveaux supports, tels que les CD-ROM. La nouvelle ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) contenait entre autres des détails sur les exigences techniques d’un tel classement. En voici les nouvelles exigences:
- l’art. 9 Olico pour les données numériques, p. ex. un horodatage et une signature numérique,
- l’art. 3 Olico stipule qu’aucune modification ne peut être apportée aux données sans qu’il soit possible de le constater,
- l’art. 8 Olico, selon lequel les accès doivent être enregistrés (cela vaut également pour les archives sur papier!).
Type d’archivage autorisé selon l’Olico
Si l’on considère l’art. 9 Olico dans le détail, cette disposition autorise la conservation sur des supports d’information inaltérables et modifiables.
Le papier, les supports d’images et les supports de données inaltérables sont cités comme exemples de supports d’informations ad hoc. Le papier est sans doute le support le plus facile à utiliser pour une entreprise ou une PME. Or, se pose déjà la question de la durée de lisibilité d’un support inaltérable tel qu’un CD (un CD-RW serait modifiable). Selon l’entreprise, les données doivent être conservées plus longtemps que les dix ans que l’on mentionne généralement. Pour les immeubles optés, la TVA exige une conservation pendant 20 ans (plus cinq ans de délai de prescription). Si l’on veut faire valoir une imposition sur la marge, la durée de conservation est illimitée, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’on a besoin du document.
La conservation sur papier requiert un endroit protégé contre les influences néfastes et contre la consultation par des personnes non autorisées, et ce, pendant de nombreuses années. Si l’on prend l’exemple des reçus thermiques, il faut que le papier reste lisible pendant de nombreuses années. Il faut également savoir que l’espace d’archivage n’est pas gratuit. Les supports d’information modifiables peuvent être conservés si l’intégrité des informations enregistrées et le moment de l’enregistrement peuvent être prouvés de manière infalsifiable, par exemple par un procédé de signature et d’horodatage.
Avantage de l’archivage numérique: il nécessite nettement moins d’espace d’archivage, et le journal de bord permet de savoir sans problème qui a accédé à un fichier.
Inconvénient: les coûts d’un archivage numérique conforme à la loi. Une signature numérique nécessite un contrat spécifique avec un prestataire de services, afin que la qualité originale d’un fichier puisse être confirmée à tout moment, même dans un avenir lointain. Il faut en outre une infrastructure qui permet d’enregistrer correctement les justificatifs courants. En sus des coûts pour l’espace d’archivage, il faut escompter désormais des coûts pour la signature ainsi que pour un lieu de stockage numérique sécurisé. Les petites entreprises devront supporter des coûts supplémentaires pour l’assistance informatique afin de satisfaire aux exigences de l’Olico.
Problème: art. 9 Olico/interventions politiques
L’expérience a montré que pour les petites entreprises, les exigences de l’art. 9 Olico constituent un frein à un classement numérique de type professionnel. On s’est en effet rapidement aperçu qu’il ne suffisait pas de scanner les factures des créanciers et de les classer ensuite au format PDF. Si un fichier affiche effectivement une date et une heure sur l’ordinateur, ces données peuvent néanmoins être manipulées. Sans procédure de signature et d’horodatage, impossible de prouver le caractère original d’un document.
L’introduction de l’art. 81 al. 3 LTVA signifie que le principe de la libre appréciation des preuves s’applique. Lors d’une révision de la TVA, la déduction de l’impôt préalable pourrait donc être autorisée en cas de justificatif ne comportant pas de signature correcte. Si, dans le cadre d’une telle révision, des doutes apparaissent quant à l’exactitude des données, l’art. 122 OTVA prévoit que ce sont les dispositions de l’Olico qui prévalent.
Remarque: Il convient également de noter que d’autres lois fiscales ne connaissent pas de telle disposition concernant la libre appréciation des preuves. Une révision sur la base des prescriptions de la LIFD considérerait selon l’art. 126 comme étant également correcte une conservation selon l’art. 958f CO.
Cette réglementation, jugée peu favorable aux entreprises, a donné lieu par la suite à des interventions politiques visant à simplifier les exigences en matière de classement numérique.
Recommandations de produits
Une motion déposée le 25 août 2015 et suivie d’une interpellation a prié le Conseil fédéral de réduire les exigences en matière de TVA pour le classement numérique des factures. Celui-ci a rejeté une modification de la loi et a indiqué que la liberté des moyens de preuve selon l’art. 81 al. 3 LTVA laissait déjà une marge de manoeuvre suffisante. Dans une précision de la pratique publiée le 27 septembre 2016, l’AFC titrait: «Pas d’obligation de signature numérique». Les explications données à l’époque se retrouvent aujourd’hui dans les «Questions & réponses sur le commerce électronique» à la question «Y a-t-il une obligation de signature numérique?». En se référant à cette précision de la pratique, le Conseil fédéral a fait savoir que les art. 122 ss. OTVA seraient adaptés en conséquence. Cette adaptation est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, l’art. 9 Olico est resté inchangé. En matière de TVA, c’est l’entreprise soumise à l’obligation de tenir une comptabilité qui assume le risque de voir une pièce justificative jugée correcte dans le cadre de la liberté des moyens de preuve.
Une autre motion demandait à nouveau une adaptation de l’art. 9 Olico. «La signature numérique des pièces justificatives ou l’utilisation de procédés similaires doivent être facultatives». Le Conseil national a accepté la motion, mais le Conseil des Etats l’a rejetée. Dans sa prise de position du 23 février 2022, le Conseil fédéral a précisé que, pour les supports de données modifiables, l’intégrité des données enregistrées et le moment de l’enregistrement doivent pouvoir être prouvés. Il explique ensuite que «le texte de l’ordonnance cite expressément comme exemple les procédés de signature numérique et les horodatages». L’utilisation de procédés de signature numérique n’est donc qu’une possibilité, «mais pas une condition obligatoire pour l’établissement de données comptables numériques». Il n’y a donc pas d’obligation d’utiliser une signature électronique selon l’Olico. Une adaptation est donc inutile.
Le Conseil fédéral se réfère dans ses explications à l’acceptation des documents numériques par les autorités fiscales. Il convient toutefois de noter que ce genre de justificatifs peuvent également servir de moyens de preuve dans le cadre d’une demande d’édition dans un procès civil, par exemple. Conformément à l’art. 178 CPC, la partie qui se prévaut d’un document doit en prouver l’authenticité si celle-ci est contestée par l’autre partie. Le Tribunal fédéral a déjà confirmé la qualité de client original des enregistrements numériques dans un arrêt de 1985.
Variante possible pour l’horodatage et la procédure de signature
Pour pouvoir prouver l’intégrité des données sur un support modifiable, il faudra qu’une tierce partie soit impliquée, au moins sur le plan technique. Un exemple auquel le Conseil fédéral pourrait avoir fait allusion dans sa prise de position du 23 février 2022 est la technique de la blockchain. Sur cette base, le droit à un registre de droits-valeurs peut être prouvé conformément à l’art. 973d CO. Les actions ne sont pas les seules à pouvoir être suivies au moyen de la blockchain, d’autres documents – notamment les pièces comptables – pourraient également être suivis. L’objectif de la législation, avec laquelle l’art. 973d CO est également entré en vigueur, est de «[...] continuer à améliorer les conditions permettant à la Suisse de se développer en tant que site leader, innovant et durable pour les entreprises de technologie blockchain/distributed ledger (DLT)».
Au lieu de la signature numérique avec horodatage, une blockchain pourrait ainsi contribuer à garantir l’intégrité d’un document comptable. L’art. 973d al. 2 ch. 2 CO exige toutefois que l’intégrité d’un tel registre soit protégée par «[...] des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la gestion commune par plusieurs personnes indépendantes les unes des autres [...]». Comme pour l’horodatage et la signature numérique, une telle solution nécessite donc la collaboration d’un tiers.
Nouveau défi: conservation des documents de reporting non financier
Un rapport sur les questions non financières rend compte des préoccupations environnementales, sociales et relatives aux employés, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Les art. 964c, 964h et 964l CO renvoient à l’obligation de conservation des documents comptables. Cette obligation de reporting non financier ne concerne à première vue que les grandes entreprises, mais lorsqu’il s’agit de documenter une chaîne d’approvisionnement, même les petits fournisseurs devront transmettre des données à leur grand client.
Ces grandes entreprises doivent conserver les rapports correspondants ainsi que les pièces justificatives qui servent de base à ces rapports. On peut imaginer par exemple:
- des photos satellites pour montrer l’état d’une zone autour d’une mine,
- des photos prises par des drones pour prouver le déboisement et le reboisement,
- des certificats attestant qu’aucun travail d’enfant n’est impliqué (même si, en fonction de l’indice de corruption du pays concerné, ces certificats ne sont pas encore significatifs),
- des attestations de négociants certifiés pour d’éventuels minerais de conflit,
- etc.
Remarque: Il ne s’agit donc plus seulement de classer des documents comptables. Les exigences relatives à ce qui doit être conservé et à la manière dont sa qualité d’origine peut être confirmée vont bien au-delà (format RAW pour les photos, car un JPG pourrait déjà être manipulé?)
Conservation des comptes annuels et du rapport de révision
Selon l’art. 958f al. 2 CO, «le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être conservés par écrit et signés». La question se pose de savoir si un document papier doit être conservé ici ou si un classement numérique est possible.
La fonction de la signature est parfaitement claire: dans un arrêt de 2014, le Tribunal fédéral a souligné à ce propos qu’elle permettait de confirmer l’exactitude des indications figurant dans le compte de résultat et le bilan.
La disposition suivante du CO s’appliquait jusqu’au 31 mai 2002: «Le compte d’exploitation et le bilan doivent être conservés en original; les autres livres de comptes peuvent être conservés sous forme d’enregistrements sur des supports d’images, la correspondance commerciale et les pièces comptables sous forme d’enregistrements sur des supports d’images ou de données, si les enregistrements correspondent aux documents et peuvent être rendus lisibles en tout temps. Le Conseil fédéral peut préciser les conditions».
La formulation en vigueur du 1er juin 2002 au 31 décembre 2011 était la suivante: «Le compte d’exploitation et le bilan doivent être conservés sous forme écrite et signée. Les autres livres comptables, les pièces comptables et la correspondance commerciale peuvent également être conservés sous forme électronique ou d’une manière comparable s’ils peuvent être rendus lisibles en tout temps».
Une distinction claire a donc été faite entre le fait que le compte d’exploitation et le bilan doivent être sur papier et que les autres registres peuvent être conservés sous une autre forme.
Dans le droit actuel, deux alinéas différents traitent de ce qui était formulé jusqu’à présent dans un seul.
L’art. 958f al. 2 exige que les comptes annuels et le rapport de révision soient conservés par écrit et signés. L’al. 3 précise ensuite que les livres comptables et les pièces justificatives peuvent être conservés sur papier, sous forme électronique ou d’une manière comparable.
Ce n’est que depuis 2005, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la version du CO à partir du 1er juin 2002, que ce dernier stipule à l’art. 14 al. 2bis qu’une signature numérique dûment certifiée est équivalente à une signature manuscrite. La loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique en a constitué la base. Une facture annuelle ou un rapport de révision peuvent donc aussi être signés numériquement.
Mais doivent-ils quand même être conservés sous forme papier? La distinction claire faite jusqu’ici dans la formulation des prescriptions de conservation des anciennes dispositions du CO plaide en ce sens. Le fait que l’évolution numérique et la législation en la matière aient constamment changé s’y oppose. En Allemagne, l’art. 126a du BGB a complété la loi en faisant explicitement référence à la signature numérique.
Un tel complément du CO fait défaut jusqu’à présent dans la loi suisse. On peut se demander si la «best practice» des entreprises de révision n’a pas déjà anticipé une telle adaptation de la loi.
Dans un rapport du Comité «Aide à la digitalisation et à la transformation» d’EXPERTsuisse, on part du principe qu’une «signature des rapports de révision et des documents contractuels (p. ex. lettres d’engagement, etc.) est répandue et utilisable en fonction de l’acceptation des clients».
Ainsi, le rapport de révision devrait être disponible sous forme numérique (p. ex. PDF signé) chez le client, afin que l’exactitude du certificat de signature numérique et de la date puisse être vérifiée.
Depuis ce rapport d’EXPERTsuisse, l’Autorité de surveillance en matière de révision (ASR) a certainement déjà contrôlé à plusieurs reprises la méthode de travail des entreprises de révision. Jusqu’à présent, l’ASR n’a pas connaissance d’un cas dans lequel un rapport de révision signé numériquement a été envoyé numériquement à un client.
Par analogie, cela signifie pour le rapport de gestion à conserver par écrit que les signatures doivent être apposées au moyen d’une signature électronique qualifiée afin que le document numérique réponde aux exigences de l’art. 9 Olico et que les signataires soient clairement identifiables.
Conclusion
Au vu des explications sur les modifications du CO, une autre solution peut donc être utilisée pour prouver l’originalité d’un fichier si la blockchain est installée en conséquence.
Reste à savoir si le Tribunal fédéral jugera qu’un rapport de gestion déposé sous forme de fichier avec une signature certifiée est écrit et signé conformément au CO. Si le législateur procède auparavant à une adaptation comme en Allemagne, le cas serait clair.